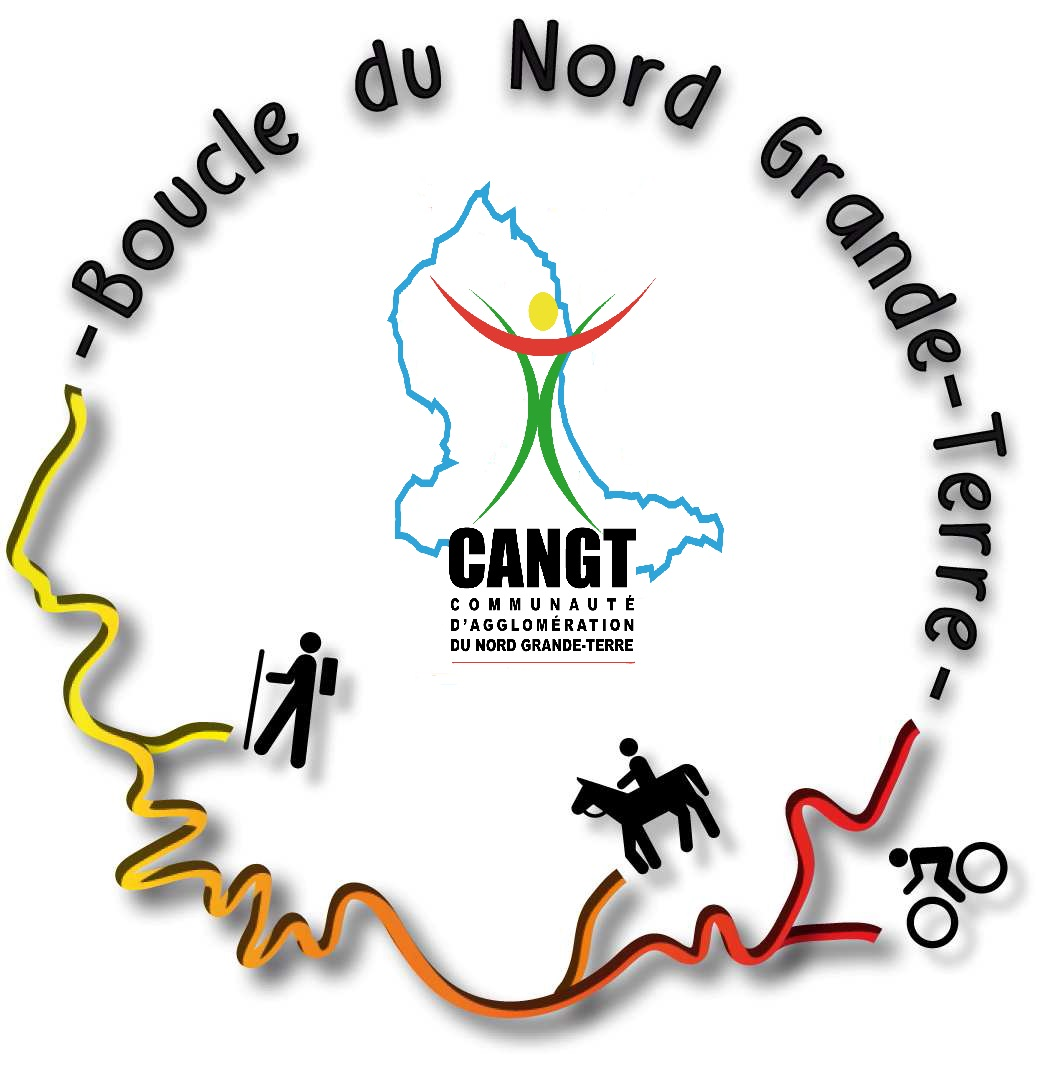Photo : Murielle MANTRAN
L'ancienne prison communale
Sous l’effet, notamment, de la décomposition progressive du système esclavagiste, les affaires de justice relevant de la cour d’assises se multiplient dans les années 1830. Pour faire face à l’augmentation des incarcérations, le gouverneur de Guadeloupe fait construire des geôles civiles dans la plupart des communes. A l’exemple de celle de Petit-Canal, elles obéissent à un plan type qui emprunte beaucoup à l’architecture militaire. Les deux bâtiments rectangulaires d’un seul niveau sont constitués d’épais murs maçonnés recouverts d’un enduit, laissant apparentes les pierres de taille qui forment les encadrements des baies, les chaînes d’angles et les bandeaux. Ils sont ceints par un mur de clôture qui inclut la façade du bâtiment d’entrée, laquelle est percée d’une seule porte en plein cintre constituant l’unique accès. Au cours du XXe siècle, une autre prison plus moderne est édifiée dans le bourg. L’abandon de l’ancienne prison a permis aux figuiers maudits d’étendre leurs branches et leurs racines dans les maçonneries, créant une ambiance à la fois inquiétante et poétique.
À son origine, le feu était alimenté au gaz, une technologie courante pour les installations isolées. En 1970, il fut intégré au réseau des feux à éclats électriques, marquant un tournant dans la modernisation de la signalisation maritime locale. Aujourd’hui, ce feu fonctionne grâce à des panneaux photovoltaïques, affirmant une transition vers des énergies renouvelables et une autonomie énergétique.
Ce feu demeure un repère essentiel pour les navigateurs et symbolise l’adaptation continue des infrastructures maritimes aux besoins modernes tout en préservant leur rôle patrimonial.
Source : Séverine LABORIE